Vieillir est une expérience universelle, mais elle ne se vit pas de la même manière partout dans le monde. En Afrique de l’Ouest, l’allongement progressif de l’espérance de vie, la transformation des familles et la fragilité des systèmes sociaux placent la question du vieillissement au cœur des enjeux de société. Pourtant, le sujet reste encore peu abordé publiquement, souvent relégué au rang de question intime ou familiale. Or, vieillir en Afrique aujourd’hui est une réalité collective qui mérite d’être comprise, anticipée et valorisée.
1. Une démographie en mutation
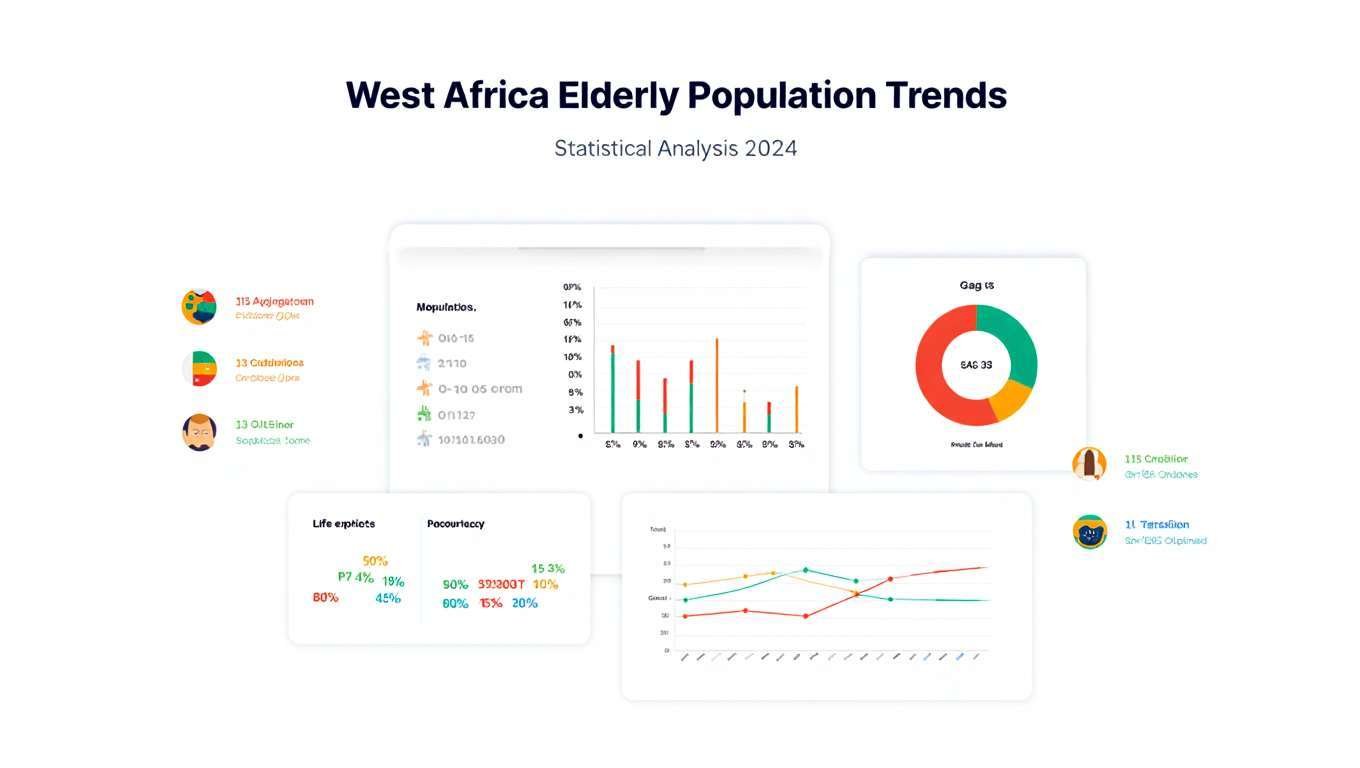
L’Afrique a longtemps été perçue comme un continent « jeune ». Effectivement, plus de 60 % de la population a moins de 25 ans. Mais ce constat occulte une autre réalité : le nombre de personnes âgées augmente rapidement. Selon les projections des Nations Unies, la population des plus de 60 ans en Afrique subsaharienne pourrait passer de 46 millions en 2015 à plus de 161 millions en 2050.
En Afrique de l’Ouest, l’espérance de vie progresse régulièrement :
- En Côte d’Ivoire, elle est passée de 50 ans dans les années 1990 à près de 58 ans en 2023.
- Au Sénégal, elle atteint environ 67 ans, et au Ghana, 64 ans.
Ces chiffres restent en deçà des standards mondiaux (plus de 72 ans en moyenne), mais ils traduisent une transformation silencieuse : les générations vivent plus longtemps, et l’idée même d’une « vieillesse » prend une nouvelle dimension.
2. Les défis du vieillissement en Afrique de l’Ouest

a. Santé fragile et accès limité aux soins
Les systèmes de santé ouest-africains sont encore centrés sur les maladies infectieuses et materno-infantiles. Les maladies chroniques liées à l’âge – diabète, hypertension, cancers, Alzheimer – restent mal prises en charge. Dans de nombreux pays, les personnes âgées n’ont pas accès à une couverture maladie ou à des soins spécialisés. L’automédication et les médecines traditionnelles comblent souvent ce vide, avec des résultats inégaux.
b. Une protection sociale quasi inexistante
Dans la plupart des pays de la région, moins de 20 % des travailleurs bénéficient d’une retraite formelle. La grande majorité vieillit sans pension, dépendant de leurs enfants ou de leur activité dans l’économie informelle. Ce modèle, longtemps soutenu par la solidarité familiale, s’essouffle face à la pression économique et aux transformations sociales.
c. Isolement croissant dans les villes
Historiquement, les aînés vivaient entourés, au cœur de familles élargies. Mais l’urbanisation, la migration et la mondialisation redessinent les solidarités. Dans les grandes villes comme Abidjan, Dakar ou Accra, on observe de plus en plus d’aînés seuls à la maison pendant que les enfants travaillent, ou marginalisés dans des quartiers où les liens communautaires s’effritent.
d. Représentations sociales ambivalentes
Vieillir reste associé, dans l’imaginaire collectif, à la sagesse et au respect. Mais dans la réalité, les aînés sont parfois perçus comme fragiles, surtout lorsqu’ils perdent leur autonomie. Cette ambivalence pèse sur la dignité de l’âge.
3. Une richesse encore trop peu valorisée
Malgré ces défis, les aînés d’Afrique de l’Ouest représentent une ressource humaine et sociale considérable. Ils détiennent la mémoire des familles, des traditions et des communautés. Beaucoup continuent d’être actifs bien après 60 ans : commerçants, artisans, agriculteurs, conseillers spirituels, médiateurs familiaux.
Dans les zones rurales, ils jouent un rôle central dans la transmission des savoirs agricoles et culturels. Dans les villes, ils participent à l’éducation des petits-enfants, souvent en première ligne lorsque les parents travaillent ou migrent.
Pourtant, cette contribution n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur. L’absence de politiques publiques dédiées et de programmes de valorisation des savoirs traditionnels fait que cette richesse s’érode.
4. Prenons l’exemple de Mariam…

A 72 ans, veuve depuis dix ans, elle a élevé ses enfants en vendant des beignets au marché. Aujourd’hui, trois de ses enfants sont partis travailler à l’étranger, les autres vivent à Abobo et Treichville. Mariam vit seule, entourée de voisins bienveillants.
Chaque matin, elle fait de la marche avec deux amies de son quartier. Mais lorsqu’elle a fait une crise d’hypertension, elle n’a pas pu payer son traitement immédiatement. Ses enfants ont contribué, mais à distance. Mariam n’est pas « dépendante » au sens médical, mais elle vit au quotidien les défis du vieillissement : l’accès aux soins, la solitude de certaines journées, et le regard parfois condescendant de son entourage.
L’histoire de Mariam n’est pas isolée. Elle illustre les réalités de milliers d’aînés en Afrique de l’Ouest : actifs, résilients, mais vulnérables dans un environnement qui n’est pas toujours pensé pour eux.
5. Vieillir en Afrique : un défi collectif
Le vieillissement n’est pas seulement une affaire individuelle ou familiale : c’est une question de société. Trois pistes émergent pour l’Afrique de l’Ouest :
- Repenser la santé : renforcer la prévention, former des professionnels aux maladies liées à l’âge, développer des centres de santé de proximité accessibles aux aînés.
- Inventer des modèles de protection adaptés : créer des mécanismes simples d’épargne et de solidarité, même dans l’économie informelle, pour sécuriser la vieillesse.
- Créer des espaces de lien et d’épanouissement : clubs, associations, lieux intergénérationnels où les aînés restent actifs, connectés et valorisés.
Des initiatives émergent déjà, souvent portées par la société civile. Le Club de Baly s’inscrit dans cette dynamique en proposant des activités qui stimulent le corps, l’esprit et le lien social, tout en offrant aux familles un soutien précieux.
Changer de regard
Vieillir en Afrique aujourd’hui, c’est affronter de multiples défis : santé fragile, absence de protection sociale, isolement urbain. Mais c’est aussi une chance, car nos sociétés disposent d’une richesse humaine, culturelle et relationnelle immense.
La question est simple : voulons-nous considérer nos aînés comme une fragilité, ou comme une ressource à valoriser ?
En choisissant la deuxième voie, nous construisons des sociétés plus solidaires, plus justes et plus résilientes.
Car vieillir n’est pas un problème à résoudre : c’est une étape de vie à accompagner, à honorer et à célébrer.



